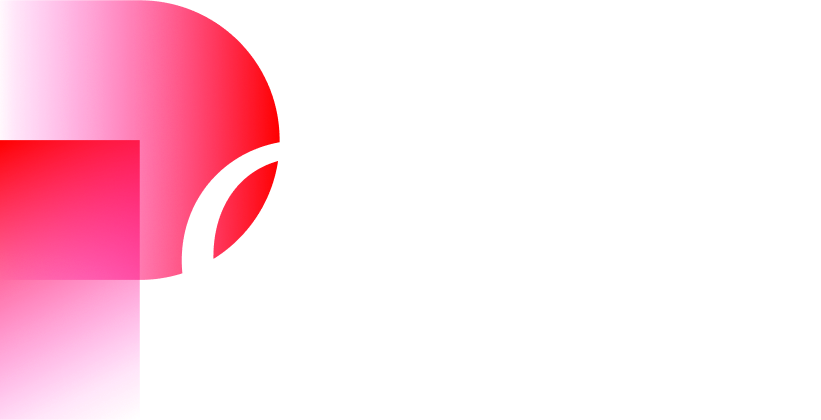Même si l’on sait que Verdi a dû en passer par la torture de la censure, je considère sa dernière version – où il n’est plus question du roi Gustave III de Suède mais du gouverneur de Boston – comme la plus cohérente. Du reste, Verdi n’était pas intéressé par une psychologie très approfondie pour cette oeuvre : il était à un moment de sa vie où, au contraire de ce qui l’animait pour Simon Boccanegra, il cherchait à dépeindre des sentiments forts plutôt qu’à traiter du désespoir en politique.
Ici, le monarque éclairé incarne le symbole du buongoverno, cette bonne gouvernance qui, dès l’acte I, dans la salle d’audience du gouverneur, laisse entendre son inébranlable bonté malgré les voix de basses qui, telles qu’en tout mélodrame du xixe siècle, sont celles des traîtres et des conspirateurs. On y voit aussi paraître Oscar, la face innocente du destin, le messager par qui arrivent les bonnes nouvelles qui se révèleront fatales. L’existence d’Ulrica est aussi mentionnée dès ce premier acte, de sorte que nous voyons coexister des traîtres au sein d’un monde donné pour harmonieux.
Souvent, chez Verdi, de tels personnages ont en charge d’incarner des marginaux de la société. Ulrica appartient à ce monde des intuitions que nous avons refoulé et, dans ma mise en scène, ce monde est incarné par un choeur de femmes, prêtresses d’un culte dont le symbole est le serpent. Dans cet univers, il m’a semblé intéressant de poser Ulrica comme une prêtresse du culte vaudou.
Le thème de la plante magique pourvoyeuse d’oubli, cette plante qu’Ulrica invite Amelia à cueillir, on le trouve déjà dans Shakespeare, et cette force des plantes, on la connaît aussi en Occident avec le mythe de la mandragore censée naître du dernier spasme des pendus… Lorsque le gouverneur, Riccardo, décide comme par bravade de consulter Ulrica, on voit bien la difficulté de ce rôle : d’un côté, c’est un « positiviste » comme on disait du temps de Verdi, mais il y a en lui, aussi, cette part de goût pour le divertissement et, dans le même personnage, un mélange de comique et de tragique, comme c’était déjà le cas avec le Duc de Mantoue dans Rigoletto : une frivolité mêlée de gravité avec laquelle Verdi s’amuse.
Le compositeur en joue comme il joue avec l’irrationnel, à la manière dont, aujourd’hui, nous nous moquons des horoscopes dans les magazines. Il n’en demeure pas moins que dans sa vision « décalée » d’« être marginal », Ulrica a senti la présence des conspirateurs… Un décor unique et synthétique montre la salle d’audience. Je ne prétends pas que ce gouverneur, Riccardo Warwick, soit tel le président Lincoln, mais ce décor doit pouvoir évoquer l’élévation de l’esprit dont l’aigle est le symbole – orgueil compris. En ce sens, c’est un décor politique mais il ne s’agit pas là d’un petit salon où l’on attend les dépêches. Je l’ai voulu plus grand que cela et plus lyrique.
Quant à son versant opposé, on n’y trouve plus d’éléments d’architecture, ni de sol brillant noir, mais la terre qui est le domaine dont le serpent, ayant pris la place de l’aigle, est le totem, le symbole d’un psychisme obscur : le domaine d’Ulrica, à qui les personnages du premier tableau vont rendre visite pour se divertir. L’aigle, c’est la raison, le pouvoir. Le serpent, c’est le pouvoir de la nuit, ce sont les ténèbres et c’est aussi le féminin, le chtonien. Autant de croyances symboliques occultées chez nous par une pression historique qui cependant ne les a pas fait disparaître. Le vrai sujet de cette oeuvre, c’est l’amour impossible ; le plus grand désespoir dans l’amour qui tient au fait, comme dans Tristan et Isolde avec le Roi Marke, que le rival est l’ami le plus proche et que cette amitié ne tolère pas la trahison.
Ainsi, lorsque le gouverneur est poignardé au cours du bal, chacun découvre ce contraste : la plus grande extériorité de la vie sociale confrontée au plus intime de l’amour et de l’amitié. Il en résulte que trois vies sont détruites à la fin. Le noir de la tragédie y domine. La face cachée. L’aigle noir. Une chose étrange figure dans la distribution au sujet de Renato dont on précise qu’il est « créole ». Créole, c’est-à-dire né aux États-Unis. Il est également précisé que des créoles figurent dans le bal. S’agissait-il de sang-mêlés dans l’esprit du librettiste ? Ce qui demeure c’est que, par son intransigeance avec sa femme, laquelle confine au sadisme, par sa jalousie qui n’est pas sans rappeler Otello, Renato renvoie directement à une psychologie caractéristique du xixe siècle.
Dans la peinture de cette passion, c’est comme si Verdi était en quête d’une nouvelle forme, renonçant jusqu’à un grand air d’entrée pour Amelia, comme si, déjà, l’idée de la prima donna était à ses yeux révolue. On sent là que Verdi va vers ses grandes oeuvres : Don Carlo, Otello, Falstaff… Les grands moments lyriques de l’acte II sont suprêmement beaux, quand la musique est la plus absolue : une explosion lyrique de sentiments. Comme chez Mozart, on finit par se demander si l’on préfère les récitatifs ou les airs. Mais je ne fais jamais de choix entre l’expression du sentiment et ce qui fait avancer l’action. À mes yeux, chaque mètre cube du plateau doit être rempli de drame et de musique. Telle est la leçon de mon vieux maître Strehler.