Ouvertures à la vente
Réservez vos places dès à présent pour La Belle au bois dormant, Il Viaggio, Dante, Sharon Eyal / Mats Ek, Don Carlos, Il Trittico, les Démonstrations de l'École de Danse...
Ouvertures à la vente
Réservez vos places dès à présent pour La Belle au bois dormant, Il Viaggio, Dante, Sharon Eyal / Mats Ek, Don Carlos, Il Trittico, les Démonstrations de l'École de Danse...

La Fille du régiment
Des prix à tomber par terre pour une femme de caractère
Opéra Bastille
du 17 octobre au 20 novembre 2024


The Rake's Progress
Igor Stravinsky
Palais Garnier
du 30 novembre au 23 décembre 2024
En ce moment
Voir le calendrierÀ ne pas manquer
Voir toute la programmation
Opéra
Madame Butterfly
Giacomo Puccini
du 14 septembre au 25 octobre 2024

Ballet - Rencontre
Toï toï toï : Mayerling
Rencontre avec les danseurs Mathieu Ganio et Héloïse Bourdon
le 22 octobre 2024 à 19h00

Ballet
William Forsythe - Johan Inger
du 04 octobre au 03 novembre 2024
La vie de l’Opéra
-
Vidéo
Le mystère Mayerling : Dorothée Gilbert et Hugo Marchand en répétition
Lire la vidéo
-
Vidéo
My’Kal Stromile, entre héritage et innovation
Lire la vidéo
-
Vidéo
Imaginaire La Flûte enchantée
Lire la vidéo
-
Vidéo
Les Brigands – Immersion dans les ateliers de décors
Lire la vidéo
-
Vidéo
Dessine-moi La Flûte Enchantée
Lire la vidéo
-
Article
Le feu dans La Flûte enchantée
Lire l’article
-
Vidéo
Dessine-moi Rigoletto
Lire la vidéo
-
Vidéo
Imaginaire Rigoletto
Lire la vidéo
-
Vidéo
Dessine-moi Madame Butterfly
Lire la vidéo
Actualités
Voir toute l’actualité-
En savoir plus
17 octobre 2024
Nouveau
L'Opéra Bastille reçoit le label « Architecture contemporaine remarquable » du ministère de la Culture
-
En savoir plus
17 octobre 2024
L'Opéra en Guyane, 5ème édition
-
En savoir plus
23 septembre 2024
Adieux à la scène de la Danseuse Étoile Laura Hecquet
-
En savoir plus
11 octobre 2024
Reconduction de Jean-Pierre Clamadieu à la présidence du conseil d'administration de l'Opéra de Paris
-
En savoir plus
01 octobre 2024
Message aux spectateurs de Madame Butterfly le 1er octobre à 19h30 à l'Opéra Bastille
-
En savoir plus
11 septembre 2024
Découvrez les premières images du "Lac des cygnes" filmé pour IMAX, bientôt dans les cinémas du monde entier
-
En savoir plus
20 août 2024
POP s'enrichit de documentaires inédits
-
En savoir plus
16 juillet 2024
L'Opéra de Paris annonce la composition du nouveau Junior Ballet
-
En savoir plus
15 juillet 2024
L’Opéra de Paris lance Coddess Variations, une nouvelle collection d'art numérique à la croisée de la sculpture et de la danse
-
En savoir plus
14 juillet 2024
Relais de la Flamme Olympique et cours public le 14 juillet
Artistes à l’affiche
Voir tous les artistesL’Opéra en streaming
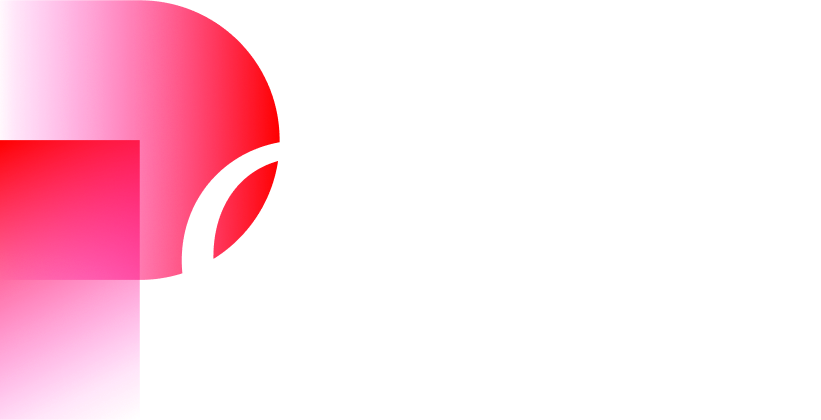
Avec POP, le site de streaming de l'Opéra de Paris, regardez nos plus beaux spectacles où que vous soyez.
Essai gratuit 7 jours
-
00h22
00h22
-
00h32
00h32
-
02h40
Live mercredi 6 novembre à 19h30
02h40
-
00h27
00h27
-
02h18
02h18
-
Danser à Tokyo : les secrets d’une tournée
NOUVEAUTÉ
Une série documentaire inédite à découvrir à partir du 1er septembre
-
00h33
00h33
-
02h05
Live mardi 17 décembre à 20h00
02h05
-
01h33
01h33
-
02h05
02h05
Plongez dans l’univers Opéra de Paris
Espace Entreprise
-
Mécénat et Parrainage
-
Vos opérations de relations publiques
-
Location d'espaces et tournages
-
Licence de marque, espaces publicitaires et ingénierie culturelle
-
Galas
Place de l’Opéra
75009 Paris
Place de la Bastille
75012 Paris
Haut de Page

































































