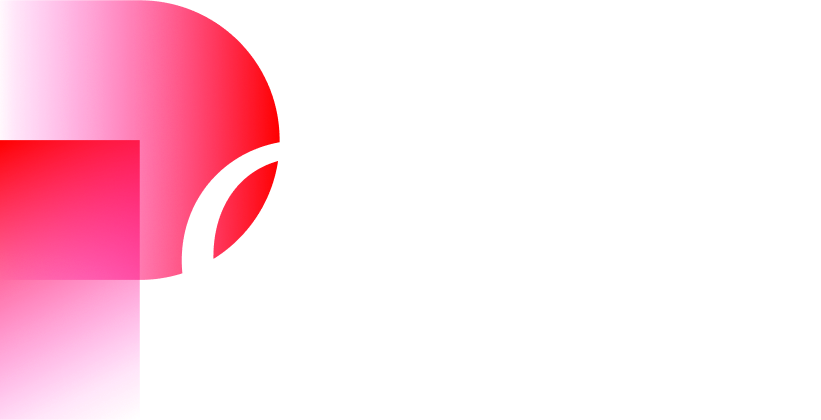En mettant en scène Carmen, j’ai avant tout cherché à libérer cet opéra des clichés. Je ne voulais pas parler de mythes, et encore moins de celui de la féminité. Je voulais un personnage humain, que l’on aborde comme ceux de Shakespeare. Ma Carmen est faite de chair et d’os. Elle n’incarne personne d’autre qu’elle‑même : une femme de son temps avec son propre ADN. Il s’agit d’un personnage très concret, comme l’est d’ailleurs Don José. Revenir à sa part d’humanité signifiait souligner ses nombreuses contradictions, les aspects noirs et les aspects lumineux de sa personnalité.
C’est commettre une erreur, je crois, de voir en Carmen une femme fatale ; elle est simplement une femme complexe aux multiples visages, qui sont tous exposés par la musique de Bizet. Carmen – pas plus que Frasquita ou Mercédès – n’est pas une prostituée. Il peut lui arriver d’entraîner les soldats, de les faire boire, de se donner à eux si elle en a envie, aussi brutaux soient‑ils, de participer à de petits trafics aussi… Mais elle est avant tout solitaire, pas spécialement éduquée, simple. Elle veut aimer, se sentir désirée, courir, voler… Je réfute l’idée qu’elle chercherait la mort et provoquerait José pour être tuée. Carmen veut vivre et se sentir vivre.
José est un homme violent et en souffrance qui lutte contre lui-même, le devoir, l’influence de sa mère, contre ses obsessions. À travers lui, j’ai voulu souligner une violence quotidienne et contextuelle. Nous vivons des temps particulièrement cruels, où l’intolérance et la violence affectent les sphères sociale, économique et bien sûr – je pense ici à l’Espagne – domestique.
Bien que je vienne d’une famille de musiciens et que je sois tombé tôt dans l’opéra, je n’ai pas abordé Carmen en portant le poids d’une tradition. Je n’avais pas d’image en tête, mon travail s’est construit à partir d’une écoute attentive de la musique. C’est un spectacle auquel nous avons donné différentes lumières qui se réfèrent aussi bien à Goya, Zurbarán qu’à celle que l’on peut goûter dans le désert marocain. Nous ne nous référons pas à une époque précise ; il pourrait s’agir de la fin du franquisme comme du début des années 1980…
Dans notre relecture, le thème de la frontière est très présent. Cela peut d’ailleurs paraître opportuniste aujourd’hui, vu l’importance médiatique prise par les questions migratoires, de le décrire comme un élément essentiel de cette production créée il y a plus de vingt ans. Mais Carmen est une frontière, au sens littéral, physique et métaphorique. Et lorsque j’ai créé le spectacle, en 1999, cette question n’était pas aussi globale et inévitable qu’elle l’est devenue. La question géographique est par ailleurs appuyée dans le traitement du plateau telle une zone désertique. Le taureau n’est pas une image de la virilité : il nous renvoie à l’idée de solitude propre à cet espace. Il est identique à ceux qui bordent les routes des Monegros, notamment, près de Saragosse. Des paysages montagneux habités sur des kilomètres par ces géants que l’on distingue par dizaines de très loin.
J’ai souhaité l’arène très simple : un cercle, métaphore du lieu clos auquel nul n’échappe. J’ai choisi d’associer à cet espace le chœur qui suggère la présence du héros absent, d’une manière bien plus imagée que s’il était en scène. La disparition du torero Escamillo du plateau se veut très cinématographique. Une lumière comme celles rencontrées chez Goya lui fait suite, qui éclaire ce moment de recueillement quand le torero prie avant le combat.