Avant-première Jeunes
Vous avez moins de 28 ans ? À midi, réservez vos places à 10€ pour l'opéra Don Quichotte de Jules Massenet.
Avant-première Jeunes
Vous avez moins de 28 ans ? À midi, réservez vos places à 10€ pour l'opéra Don Quichotte de Jules Massenet.



En ce moment
Voir le calendrierÀ ne pas manquer
Voir toute la programmation
Opéra
Street Scenes
Fragments de l’opéra de Broadway de 1948, "Street Scene"
du 19 au 27 avril 2024


Ballet
Danseurs Chorégraphes - programme 2
du 19 au 20 avril 2024
Actualités
Voir toute l’actualité-
En savoir plus
19 avril 2024
Nouveau
Don Quichotte : changement de distribution
-
En savoir plus
08 avril 2024
Tous à l'Opéra ! Édition 2024
-
En savoir plus
26 mars 2024
Bleuenn Battistoni, nommée Danseuse Étoile de l’Opéra national de Paris
-
En savoir plus
27 mars 2024
Prix de l’Arop saison 2022/2023
-
En savoir plus
20 mars 2024
La programmation 24/25 est en ligne !
-
En savoir plus
18 mars 2024
L’Opéra national de Paris et Kinoshita Group Co., Ltd. sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat d’envergure
-
En savoir plus
08 mars 2024
Don Quichotte : changement de distribution
-
En savoir plus
06 mars 2024
The Exterminating Angel : changement de distribution
-
En savoir plus
28 février 2024
Prolongation du mandat d’Alexander Neef à l’opéra de paris jusqu’en 2032
-
En savoir plus
24 février 2024
Disparition de la mezzo-soprano Anna Ringart
La vie de l’Opéra
-
Vidéo
Street Scenes en répétitions
Lire la vidéo
-
Vidéo
Dessine-moi Médée
Lire la vidéo
-
Vidéo
Podcast Médée
Lire la vidéo
-
Vidéo
De la chrysalide au papillon : les élèves de l’École de Danse répètent le spectacle annuel
Lire la vidéo
-
Vidéo
Dessine-moi Don Quichotte
Lire la vidéo
-
Vidéo
La vengeance absolue - Entretien avec David McVicar
Lire la vidéo
-
Vidéo
Dessine-moi Salomé
Lire la vidéo
-
Vidéo
Giselle, romantique et sincère
Lire la vidéo
-
Vidéo
Dessine-moi Giselle
Lire la vidéo
L’Opéra en streaming
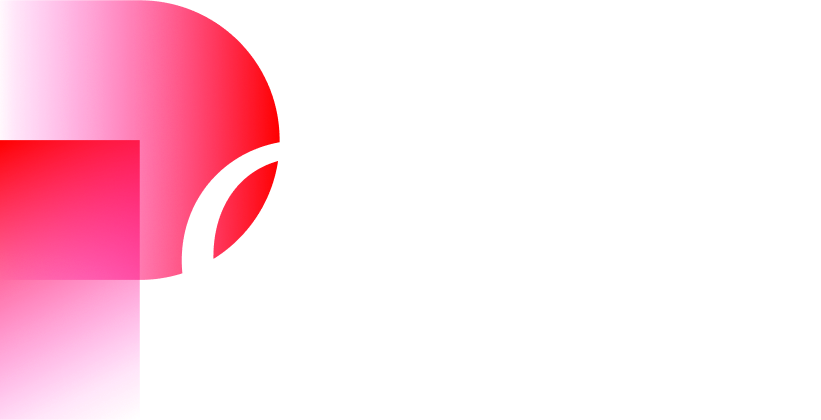
Avec POP, le site de streaming de l'Opéra de Paris, regardez nos plus beaux spectacles où que vous soyez.
Essai gratuit 7 jours
-
03h40
Live Samedi 29 juin à 19h00
03h40
-
01h00
Jiří Kylián
Ballet
01h00
-
02h05
02h05
-
00h37
00h37
-
01h22
01h22
-
00h31
L'Opéra en Guyane - Épisode 4
Documentaire
00h31
-
02h11
02h11
-
02h09
02h09
-
03h33
03h33
-
02h21
02h21
Plongez dans l’univers Opéra de Paris
Espace Entreprise
-
Mécénat et Parrainage
-
Vos opérations de relations publiques
-
Location d'espaces et tournages
-
Licence de marque, espaces publicitaires et ingénierie culturelle
-
Galas
Place de l’Opéra
75009 Paris
Place de la Bastille
75012 Paris
Haut de Page




























































