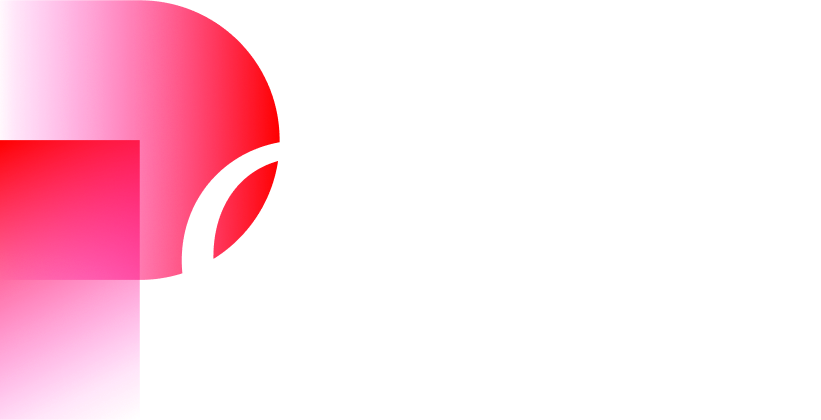On m’a séparée des autres quand nous étions très jeunes, selon l’usage. Nous étions quatre dans la portée : ma sœur Anne, mes deux frères, et moi. Mon maître avait décidé, à la mort de sa septième humaine, qu’il n’en prendrait plus. Mais de me voir si mignonne, il m’a prise, finalement.
Je savais à peine lire, à peine écrire. Mais j’étais toujours bien parée, brossée, lustrée et copieusement nourrie. On me caressait et on me récompensait. On ne me frappait jamais. Ma sœur Anne a aussi eu cette chance. Mes frères ont eu, je crois, un destin plus guerrier, l’un à la chasse, l’autre à la surveillance. Mon maître me fit construire ce qu’il pensait ressembler à notre habitat d’origine, à notre habitat dans la « nature » si une telle chose a jamais existé. Une chambre dorée, pleine de lumière artificielle qui me fait un peu mal aux yeux, mais gaie tout de même.
Dehors : le monde et ses combats. Dedans, cette douceur que nous connaissons parfois avec nos maîtres. Aventure fameuse, heureuse et malheureuse... Je lui disais : « Si tu me chasses, je dormirai sur ton seuil ».
Evidemment nous ne nous comprenons pas. Je veux dire : nous ne parlons pas le même langage. Il me comprend en regardant mes yeux, je crois. Je tends le cou vers lui. Il me caresse. Je me concentre et j’essaie de lui faire passer le message télépathiquement : « Si tu me chasses, je dormirai sur ton seuil ». Je me dis que ça marche, peut-être. Si je lui montre suffisamment d’amour et de soumission, il m’épargnera.
Il parle peu. Je crois que même pour leur espèce, il est considéré comme peu loquace. Il reçoit souvent des gens de son monde, mais il reste en retrait. Il est très riche, ce qui leur tient lieu de richesse : des choses brillantes et acérées, des ruisseaux d’une matière écarlate, des tissus ondoyants, des meubles en broderie, des pierreries cométaires, et des silos gigantesques de leur nourriture à eux. Des silos qui sont, j’imagine, de gigantesques batteries. Je ne peux qu’imaginer. Quand ils se branchent dessus à leur façon étrange, leur lueur bleue devient intense, insupportable, impossible à regarder en face.
Il m’a donné pour nom « Madame » parce que c’était l’année des M. Et pour moquer je ne sais quoi chez les humains. Pour moquer notre pauvre écriture, sans doute. Nos pauvres façons, nos manières. Je crois qu’il s’enchante de mes gestes quand ils rappellent, maladroitement, leurs gestes à eux. Ainsi nous gâtifiions autrefois avec nos chiens, nos chats, nos loups. Dans les contes que je peux lire, on les voit s’asseoir comme les humains, se chausser à l’identique, dormir dans des lits coiffés de bonnets de grands-mères.
J’attends mon maître toute la journée. Je suis démunie, sans lui. Alors j’écris. J’ai développé la technique seule à partir de mes rudiments. Je suis assise devant ce qui me tient lieu d’habitat. Une sorte de niche composée de plusieurs petits cubicules. Il n’y a pas de table. J’écris sur mes genoux, dans les marges des livres. Il montre parfois à ses invités comme je suis charmante, à refuser de loger dans l’habitacle, à être toujours installée devant. C’est une espèce de petit château, bâti dans ces matériaux luisants qu’ils ont. Un château qu’il imagine à ma taille, à mon échelle. Je fais une taille normale pour une femelle humaine, et tout est beaucoup trop petit dans ce château. Il y a un petit lit comme il imagine aux humains, où je dois dormir en boule. Il a mis gentiment à ma disposition un ensemble de livres, je crois qu’il les a mis pour faire humain, et pour leur couleur, tous rouges et dorés. Ce sont des livres avec des images et je regarde comment était la Terre. J’y lis la vie qu’on menait dans ces abris nommés châteaux. « Ce n’était que promenades, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations : on ne dormait point, et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres. » Il montre à ses invités comme je suis mignonne, un livre à la main. Je les connais par cœur maintenant, tous ces livres décoratifs.
Dans mon habitacle il y a aussi un petit lavabo et des toilettes, factices, puisque, n’étant pas concernés, ils n’ont aucun système de ce genre. Sa bande de domestiques nettoie par dessous, je crois, sous le plancher scintillant, en tout cas ça disparaît : on croirait que tout est fictif y compris moi. Des croquettes apparaissent chaque matin dans mon bol. Ce n’est pas très bon je pense, mais je n’ai aucun moyen de comparer avec la nourriture que nous étions censés consommer autrefois, prédateurs omnivores que nous étions, jusqu’à ce que cette espèce y mette bon ordre. Ils ont combiné tous les nutriments qu’il nous faut, de même qu’ils ont combiné deux atomes d’hydrogène et un atome d’oxygène, en masse, pour nous procurer de l’eau. Je dépends tellement de cette distribution automatique d’eau et de nourriture que je n’ose rien réclamer d’autre. Où trouverait-il ces pommes qu’on voit dans les contes, ces bonbons, ce miel ? Je crois que les abeilles, autrefois sur la Terre, fabriquaient le miel. Les abeilles sont de petits organismes vrombissants, jaunes et noirs, non comestibles.
Mon maître me sort de temps en temps. Je suis tellement heureuse de sortir, même dans leur paysage à eux, qui me brûle les yeux, tellement excitée que je chante dans ma tête les louanges de notre Terre perdue.
Tendres prairies, sombres forêts
Calmes rivières, ruisseaux rieurs,
Majestueuses montagnes bleues.
Je voudrais gambader. Mais il me tient serrée car mille dangers me menacent, dont je n’ai pas idée. Et comment remuer dans leur espace dévoré de lumière ? Les paysages terrestres passent dans ma tête en ronde, comme des lanternes magiques. Je ne les ai jamais vus qu’en images, certes, mais ils me plaisent.
Le monde dehors m’est interdit : qu’y ferais-je ? Dans son domaine, je peux me déplacer, sauf sur une zone précise. Mais nous sommes une espèce curieuse : qu’y puis-je ? C’est la curiosité qui autrefois nous a fait conquérir le monde, du moins les mâles de notre espèce. Car j’apprends dans les livres que seuls les mâles, c’est-à-dire 50% de nous, prenaient des bateaux et autres moyens de transport pour aller voir ce qu’il y avait derrière l’horizon. Les femelles étaient enfermées dans l’âme de leur mari. Le mari : c’est comme ça qu’on appelle le mâle dans les contes. On l’appelle parfois aussi le roi, ou le prince. Etre enfermée dans l’âme de son mari était une situation banale, c’est ce que je comprends. Je ne sais pas très bien ce qu’est l’âme : une sorte de niche ? Un ensemble de petits cubicules ?
Dans un des livres, il y a une femelle nue, comme moi, qui mord dans une pomme ; et un être nommé serpent, d’un corps très long, sans bras ni jambes. Eve est punie pour sa curiosité. Son mari s’appelait Adam, le mâle de l’espèce. J’apprends aussi que contrairement à ce que je croyais, ce sont les femelles qui donnent naissance à toute l’espèce. Ce qui explique peut-être pourquoi les mâles les tenaient à ce point sous surveillance. Je croyais que les femelles donnaient naissance aux femelles et les mâles aux mâles, comme chez nos maîtres, par scissiparité. C’est plus égalitaire. Je suis pour la scissiparité.
Mon maître a fait venir un mâle humain une fois, dans mon petit château, pour reproduction. Le mâle et moi, nous étions tous les deux si embarrassés par la situation qu’heureusement, il ne s’est rien passé d’autre qu’une conversation hâtive, où nous avons essayé d’échanger le maximum d’informations possibles sur d’autres humains domestiqués. Sur Anne, ma sœur Anne, sur mes frères, sur les siens… Et je n’ai plus jamais entendu parler de lui. Vu l’échec de sa mission biologique, ils l’ont peut-être fait piquer. Mon maître semble tenir à moi plus qu’à l’idée que j’aie des petits.
Nos maîtres, peu importe qu’ils soient mâle ou femelle, se coupent en deux, et la moitié s’en va fonder un autre module, ou une sorte d’essaim, je ne sais pas. Leurs domestiques sont très nombreux. Je ne sais pas combien de fois ils peuvent procéder à cette scission, peut-être à l’infini. C’est toute une affaire : le mien s’enferme pendant plusieurs de mes cycles de veille et de sommeil. Je pense que le processus, vers la fin, est un peu gluant, car les domestiques s’activent pour évacuer une sorte de liquide étincelant, je ne vois pas bien. De toute façon, dans ces moments-là, personne ne fait attention à moi. Je peux rester tout près de la zone interdite. Nos maîtres ressemblent à ce que mes livres montrent comme des robots, mais des robots dont l’emballage, en quelque sorte, serait organique. Ou peut-être même certaines parties intérieures, je ne sais pas. Je voudrais savoir.
Mais mon maître s’enferme dans cette zone dont l’accès m’est absolument interdit. Qu’est-ce qu’il s’y passe ? Il semblerait qu’il me tienne à l’extérieur pour une question d’hygiène : aucun de mes germes, ou de mes gênes, ne doit pénétrer le processus. Imaginez s’il en sortait une chimère mi maître, mi humaine ! Il m’a bien avertie : si j’essaie d’en passer le seuil (un sas tout de lumière, qui m’effraie et m’attire à la fois), si j’en passe le seuil, il me fera terminer comme celles qui m’ont précédée. Et après moi, il n’en prendra pas d’autre. C’est ce qu’il m’a bien fait comprendre. Trop de chagrin et trop de déception, à chaque fois.
C’est peut-être là-dedans qu’il les a fait piquer. Peut-être n’est-ce qu’un piège : quand il se lasse, il interdit l’accès de cette zone bizarre, arbitrairement. Et quand on y pénètre quand même, bien entendu, c’est la fin.
Anne, ma sœur Anne. Il me manque Anne. Si Anne était là, je lui demanderais. Si j’ai raison. D’être curieuse. D’avoir une autre ambition que de rester la créature d’un maître. Mais comment s’échapper ? Nous sommes réduits à cet état, mâles et femelles, depuis que la Terre a été retirée de sous nos pas. Nos frères eux aussi obéissent, sortent en laisse à l’heure de la promenade et mangent leurs croquettes, pas du tout comme dans les livres. Nos frères eux aussi se voient interdire de larges zones du monde, et pas seulement des portes de lumière. Nos frères eux aussi sont enfermés dans l’âme de ces géants dont nous peinons à voir le visage, dévoré de lumière bleue.
Un jour, j’irai, pour en
finir. Un jour, je trouverai la clef.
Marie Darrieussecq